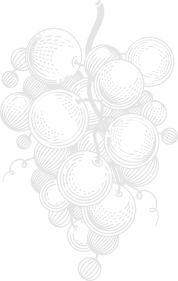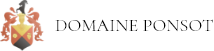L e s s a i s o n s d e l a v i g n e
A la fin de l’hiver, la taille
Respect du flux de sève (taille douce)
En cordons de royat pour les rouges
En gobelets pour les blancs (aligoté)
Au printemps, les travaux en vert
Ebourgeonnage
Relevage & palissage
Ecimage & rognages
A la fin de l’été, le temps des vendanges
Respect de la maturité phénolique
Vendanges manuelles
Tri soigné à la vigne
En automne et l’hiver
Démontage (pré-taille)
Entretien des réseaux (piquets & fils)
Repiquage
Entretien et réfection des murets
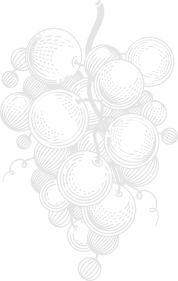


L a n a i s s a n c e d ’ u n v i n
Vin rouge
Vinification
Egrappage
Fermentation naturelle en cuve traditionnelle
Pas de sulfitage
Pigeage
Remontage
Durée, environ 3 semaines
Elevage
En tonneau de plusieurs vins (pas de fût neuf)
Pas de soutirage pendant l’élevage
Fermentation malolactique en fût
Durée, de 16 à 24 mois
Soutirage manuel avant mise en bouteille
Vin blanc
Vinification
Pressage grappe entière
Fermentation naturelle, démarrage en cuve inox et fin de fermentation en tonneau
Pas de sulfitage
Elevage similaire au rouge
En tonneau de plusieurs vins (pas de fût neuf)
Pas de soutirage pendant l’élevage
Fermentation malolactique en fût
Durée, de 14 à 18 mois